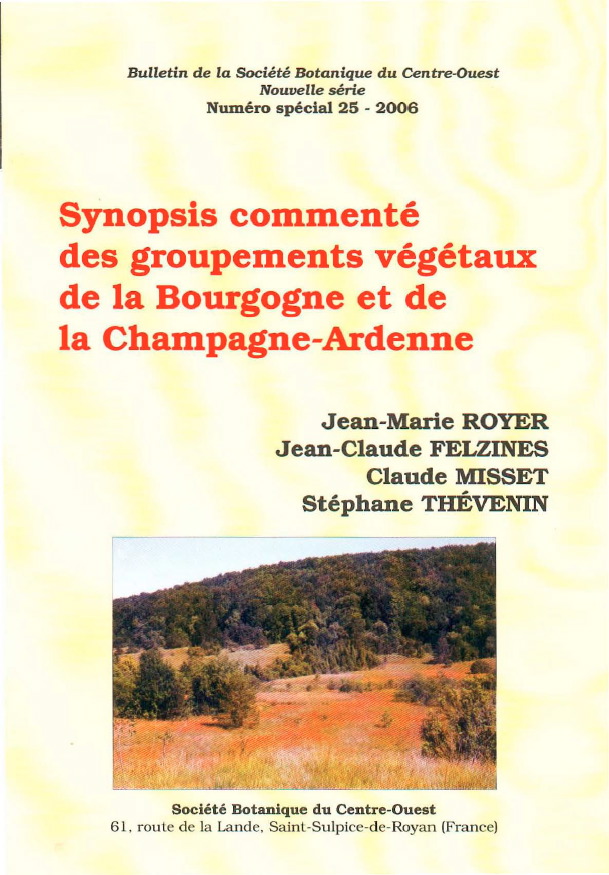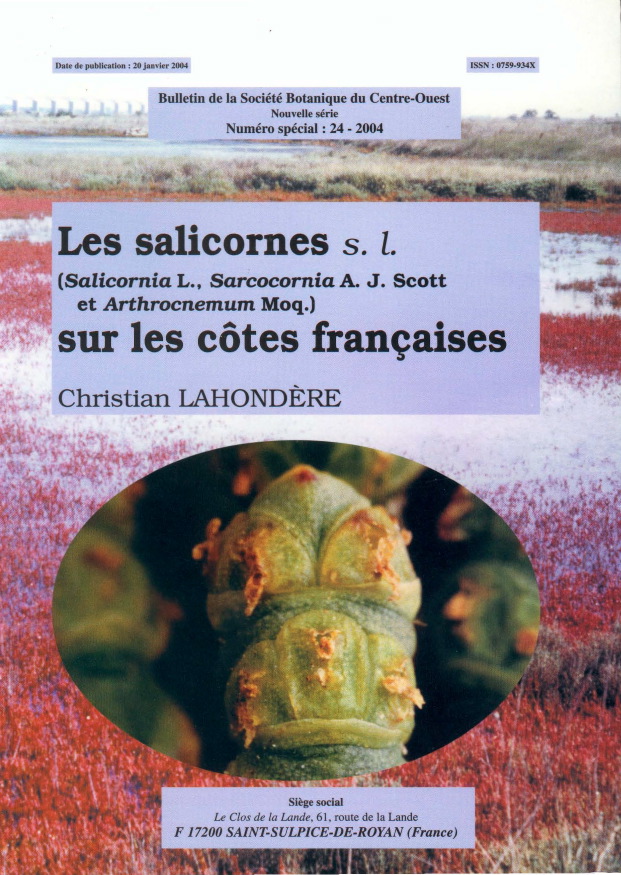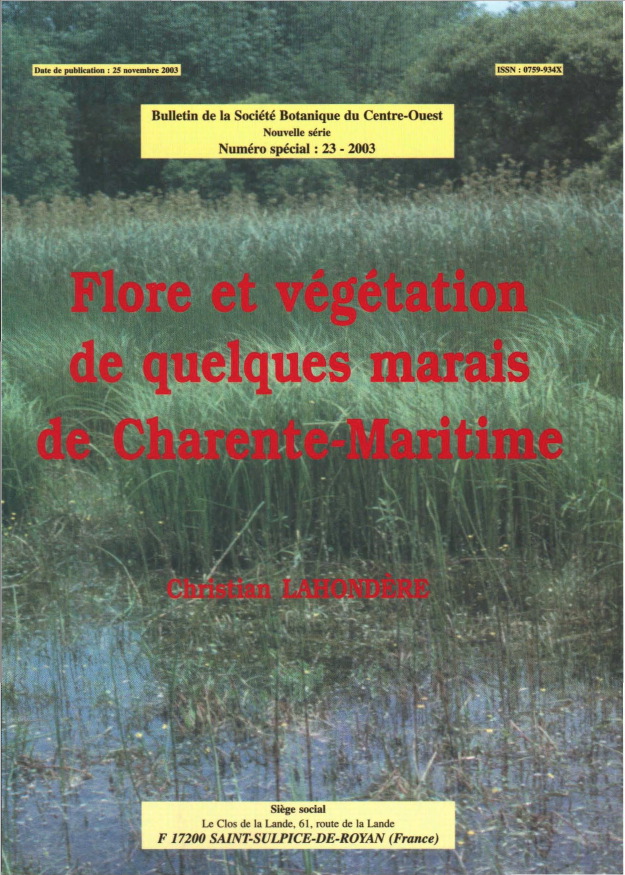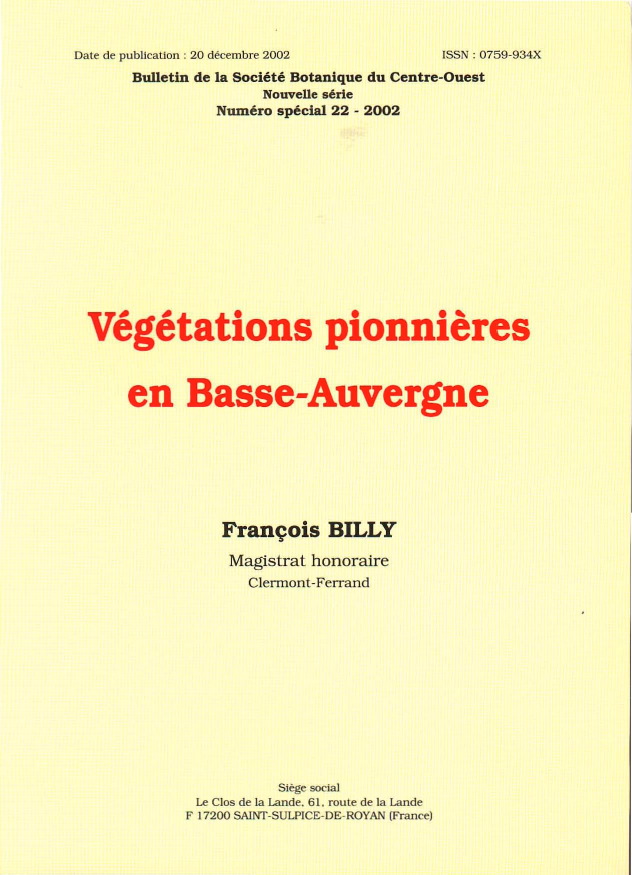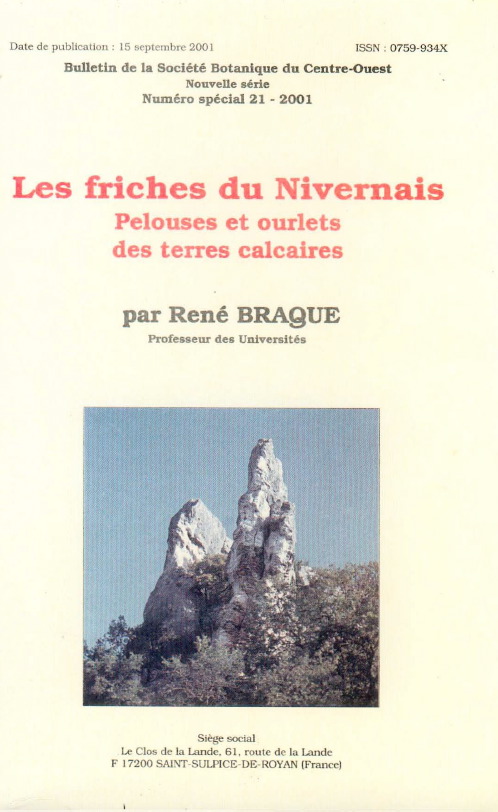Par J.-M. ROYER, J.-C. FELZINES, C. MISSET & S. THÉVENIN, 394 pages, 2005
La littérature phytosociologique française est constituée par des ouvrages anciens assez nombreux et bien connus ainsi que par des travaux récents consacrés à des entités géographiques ou (et) écologiques plus ou moins vastes qui sont éditées dans des publications variées qu’il est souvent difficile (et parfois onéreux) de se procurer. L’un des travaux synthétiques les plus célèbres consacrés à un vaste ensemble géographique est paru en 1952 : Les Groupements Végétaux de la France Méditerranéenne dont les auteurs étaient J. Braun-Blanquet, N. Rousine et R. Nègre, l’ouvrage étant préfacé par L. Emberger : ce travail connut un grand succès et fut longtemps la référence pour les botanistes languedociens et provençaux. Récemment (1994, 1996) une initiative nouvelle très prometteuse vit le jour : certains phytosociologues français furent réunis et regroupés en plusieurs ensembles thématiques et (ou) régionaux en vue de la préparation, puis de la publication d’un Prodrome des Végétations de France. Mais pour des raisons scientifiques (le territoire national était très inégalement connu), humaines et relationnelles les publications des divers groupes de travail furent très peu nombreuses; tel est le cas de l’Esquisse synsystématique et synchorologique provisoire des végétations littorales de France (1994) de J.-M. Géhu qui fut suivi d’une Végétation littorale du même auteur en 1996 et des Réflexions syntaxonomiques et synsystématiques au sein des complexes sylvatiques français (1996) du regretté J.-Cl. Rameau. On peut déplorer que les travaux de ces auteurs, spécialistes incontestés des milieux naturels qu’ils envisageaient de traiter dans le Prodrome, n’aient connu qu’une diffusion très restreinte car ce sont des publications d’une très grande importance. Pendant que paraissaient les divers volumes des Cahiers d’habitats Natura 2000 à la Documentation française, certains des phytosociologues réunis en 1994 et en 1996 préparaient un Prodrome des végétations de France qui parut en 2004 : nous en avions rendu compte dans le Bulletin 35 (2005) de la Société Botanique du Centre-Ouest. Ce Prodrome ne correspondait pas à ce que beaucoup attendaient ; cependant son intérêt est réel car il constitue la validation scientifique des ensembles de végétation de France ce qui en fait un ouvrage de référence, énorme travail ingrat réalisé par V. Boulet. Il n’en demeure pas moins que des chercheurs, souvent parmi les plus jeunes, sont demeurés sur leur faim à la réception de l’ouvrage car le Prodrome s’arrête aux alliances (voire aux sous-alliances) et ne cite pas les cortèges caractéristiques des différentes unités sociologiques. En 2005 ont été publiées dans la série des Colloques Phytosociologiques des Données pour un Prodrome des Végétations de France qui correspondent soit à des ensembles de végétation de niveaux sociologiques divers, soit à certaines parties du territoire national dont on désirait esquisser le bilan des connaissances les concernant : c’est ainsi que les quelques pages consacrées à la région Poitou-Charentes constituent la liste des ensembles végétaux reconnus lors d’un bilan réalisé dans les années 80 et n’ont donc qu’un intérêt très relatif. Il n’en est pas de même du Bilan de la connaissance phytosociologique de la Bourgogne de J.-M. Royer et de la Végétation de la Champagne crayeuse de S. Thévenin et J.-M. Royer qui pouvaient laisser prévoir un travail plus important sur ces deux régions. Deux axes de recherche avaient ainsi été proposés par les organisateurs des réunions de Paris (1994) et d’Orsay (1996) et suivis de publications diverses : – un axe thématique qui faisait l’objet de publications relativement nombreuses sur certains milieux (littoral, forêts, prairies…), beaucoup plus rares sur d’autres (milieux nitrophiles par exemple), – un axe régional parmi lesquels le très remarquable Guide des groupements végétaux de la région parisienne de M. Bournérias, G. Arnal et C. Bock (2001) mais limité à l’étude des alliances. Cette inégalité entre les deux axes de recherches s’explique parfaitement, une bonne connaissance de chaque milieu étant le préalable indispensable pour envisager la réalisation d’une synthèse qu’est la végétation régionale. J.-M. Royer, J.-C. Felzines, C. Miset et S. Thévenin ont su, après des études de terrain supposant la réalisation de milliers de relevés phytoso- ciologiques, dégager l’existence des associations végétales constituant la végétation d’un bon quart nord-est de la France et présenter un livre de phytosociologie moderne tel qu’en rêvaient nombre de participants aux travaux de 1994 et 1996. Il faut les remercier pour la réalisation de cet ouvrage dont l’intérêt dépasse très largement le cadre régional et qui doit servir d’exemple pour ce qu’il est souhaitable de faire sur tout le territoire national.